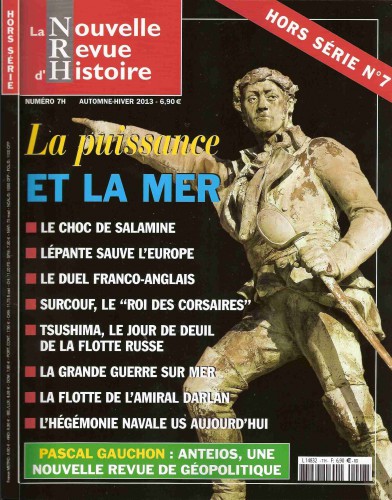Le septième numéro hors-série de La Nouvelle Revue d'Histoire est en kiosque. Il est consacré à la mer comme lieu d'expression de la puissance. On y trouve notamment, outre un entretien avec François-Xavier Dillmann ("L'expansion maritime des Scandinaves") et un autre avec Pascal Gauchon ("Histoire et géopolitique"), des articles de Philippe Conrad ("L'Europe maîtrise les mers" ; "L'empire chinois et la mer" ; "Robert Surcouf, un corsaire malouin" ; "Quand le Pacifique était un lac russe") de Jean Kappel ("La bataille de Lépante", "Alfred Mahan, théoricien de la puissance maritime" ; "La marine soviétique de l'amiral Gorchkov"), de Bernard Lugan ("L'Afrique noire et la mer"), de Martin Motte ("La pensée naval française au XIXe siècle" ; "La marine française de l'entre-deux-guerres"), de François Veaunes ("Tsushima : le jour de deuil de la flotte russe" ; "Le plan Z de l'amiral Raeder"), de Nicolas Vimar ("L'amiral Raoul Castex, le stratège inconnu" ; "Le porte-avion dans la guerre du Pacifique"), de Eric Mousson-Lestang ("La marine du Grand Turc" ; "L'autriche impériale et la mer") ou encore de Mathilde Tingaud ("Les thalassocraties crétoises et mycéniennes" ; "La bataille de Salamine" ; "Actium : la défaite de l'Orient")...
bernard lugan - Page 23
-
La puissance et la mer...
-
A propos du drame de Lampedusa...
La mort par noyade de près de deux cents migrants clandestins dans le naufrage du bateau qui les transportait, au large de l'île italienne de Lampedusa, a été l'occasion d'un beau concert médiatique de bien-pensance, destiné à culpabiliser les Européens égoïstes et indifférents... Bernard Lugan et Guillaume Faye, eux, s'intéressent aux vrais responsables du drame, dans des textes que nous avons cueillis respectivement sur le blog officiel de Bernard Lugan et sur J'ai tout compris...

Le drame de Lampedusa : une conséquence directe du renversement du colonel Kadhafi
Les vrais responsables du drame de Lampedusa sont ceux qui, pour des raisons encore bien obscures, ont déclaré la guerre au colonel Kadhafi. Comme je l’ai maintes fois dit sur ce blog, mais il importe de le redire, en dépit de tous ses défauts, le « guide libyen » était devenu un partenaire, pour ne pas dire un allié dans deux combats essentiels :
1) La lutte contre le fondamentalisme islamiste qu’il avait entrepris d’éradiquer en Libye.
2) La lutte contre l’immigration clandestine venue depuis l’Afrique sud-saharienne, la Corne ou les régions du Proche-Orient et transitant par la Libye.
Grâce aux bons rapports qu’il entretenait avec le président du Conseil italien Silvio Berlusconi, des accords très concrets avaient été conclus en ce sens et la Libye contrôlait ses côtes. Il est important de faire remarquer à ce sujet que la plupart des points d’embarquement libyens étaient situés en Cyrénaïque et que, ruinées par les interventions de la police, les mafias organisant le commerce des hommes constituèrent, avec les islamistes, le noyau de départ de la rébellion à Derna et à Benghazi. En intervenant pour empêcher les forces du colonel Kadhafi de reprendre la région, l’aviation française, sur ordre du président Sarkozy, a donc rendu un grand service aux marchands d’esclaves. Aujourd’hui, ces derniers ont repris leur lucratif « commerce » …
Le drame de Lampedusa s’explique parce que la Libye est en pleine anarchie. Le pays a éclaté en fiefs tribaux et miliciens. Le « gouvernement » n’est même pas capable de se faire respecter à Tripoli, la capitale où les milices se combattent au grand jour. Faire la liste des affrontements qui se déroulent dans le pays est impossible tant ils sont nombreux. Rien que samedi 5 octobre, jour de rédaction de ce communiqué, 15 soldats libyens furent tués au nord de Bani Walid par des islamistes présumés. Jusque là, ces derniers se contentaient de contrôler le sud de la Libye et les régions frontalières du Niger, du Tchad et du Soudan. Voilà qu’ils remontent vers le Nord afin de tendre la main à leurs « frères » qui tiennent une grande partie de la Cyrénaïque, dont les hauteurs du jebel Akdar dans l’arrière-pays de Benghazi. Or, ces islamistes ont pris le contrôle du trafic transsaharien, dont celui des migrants, avec lequel ils se financent.
L’un des résultats de l’intervention française au Mali fut de forcer les trafiquants à ouvrir de nouvelles routes vers la Méditerranée car les réseaux maffieux transsahariens de l’ouest africain furent coupés. Le principal axe par lequel la cocaïne sud-américaine débarquée en Guinée Bissau était transportée à travers le Mali jusque dans les ports du Maghreb ne pouvant plus être emprunté, les trafiquants ont donc réorienté leurs réseaux vers la Libye où il n’existe plus d’Etat. Désormais, le trafic se fait sur l’axe Nigeria-Niger-Libye. Or, à partir du nord du Nigeria avec Boko Haram, jusqu’à Benghazi et Derna, tout le trafic, dont celui de la drogue et celui des migrants, est désormais contrôlé par les islamistes.
Au lieu de faire savoir aux Européens qui sont les trafiquants qui lancent sur les eaux les pitoyables cargaisons d’êtres humains qui échouent sur les côtes européennes, les médias, largement aidés par l’Eglise pour laquelle plus le prochain est lointain et plus il semble devoir être aimé, ont au contraire entrepris de culpabiliser les populations qui subissent ces débarquements. Le drame de Lampedusa nous plonge enfin directement dans le « Camp des Saints » de Jean Raspail. Ce livre prophétique, puisqu’il date de 1973, décrit l’implosion des sociétés occidentales sous le débarquement de milliers de clandestins arrivés sur des navires-poubelle. Clandestins devant lesquels toutes les institutions s’effondrent en raison de l’ethno masochisme des « élites » européennes gavées de mièvrerie et déboussolées par un sentimentalisme qui a pris le pas sur la raison et même sur les instincts vitaux.
Bernard Lugan (Blog de Bernard Lugan, 5 octobre 2013)

Les noyés de Lampedusa : quand on culpabilise les Européens
Le 3 septembre, un navire de ”réfugiés” africains (Somaliens), en provenance de Libye (1) a fait naufrage au large de l’île italienne de Lampedusa qui est devenue une porte d’entrée admise des clandestins en Europe. 130 noyés, 200 disparus. Ils ont mis le feu à des couvertures pour qu’on vienne les aider et le navire a coulé à cause de l’incendie. Les garde-côtes italiens, ainsi que des pêcheurs, ont sauvé les survivants.
Immédiatement, le chœur des pleureuses a donné de la voix. Le maire de l’île, en larmes (réellement) a déclaré à l’agence de presse AFSA : « une horreur ! une horreur ! ». Le chef du gouvernement italien, M. Enrico Letta a parlé d’une « immense tragédie » et a carrément décrété un deuil national. Et, pour faire bonne mesure, le Pape François, qui était déjà allé accueillir des ”réfugiés” africains à Lampedusa, a déclaré : « je ne peux pas évoquer les nombreuses victimes de ce énième naufrage. La parole qui me vient en tête est la honte.[...] Demandons pardon pour tant d’indifférence. Il y a une anesthésie au cœur de l’Occident ». On croit rêver.
Sauf le respect dû au Saint-Père, il se trompe et il trompe. Et, en jésuite, pratique une inversion de la vérité. Car tout a été fait pour sauver ces Somaliens. Tout est fait pour les accueillir et ils ne seront jamais expulsés. Ils se répandront, comme tous leurs prédécesseurs, en Europe (2). Comment interpréter cet épisode ?
Tout d’abord que le Pape François cherche à culpabiliser les Européens (la ”honte”, l’ ”anesthésie du cœur”, “indifférence”) d’une manière parfaitement injuste et par des propos mensongers. Cela semble tout à fait en accord avec la position suicidaire d’une partie des prélats qui sont objectivement partisans (souvenons-nous de l‘Abbé Pierre) d’une immigration invasive sans contrôle (l’accueil de l’Autre) sous prétexte de charité. Avec, en prime, l’islamisation galopante. On pourrait rétorquer à ces prélats catholiques hypocrites qu’ils ne font pas grand chose pour venir en aide aux chrétiens d’Orient (Égypte, Irak, Syrie…) persécutés, chassés ou tués par les musulmans. N’ont-ils pas ”honte“ ?
Deuxièmement, toutes ces manifestations humanitaristes déplacées des autorités européennes, tous ces larmoiements sont un signe de faiblesse, de démission. Ils constituent un puissant encouragement aux masses de migrants clandestins potentiels qui fuient leurs propres sociétés incapables pour venir en Europe, en parasites. Certains d’être recueillis, protégés et inexpulsables.
Troisièmement – et là, c’est plus gênant pour les belles âmes donneuses de leçons de morale – si l’Europe faisait savoir qu’elle ne tolérera plus ces boat people, le flux se tarirait immédiatement et les noyades cesseraient. Les responsables des noyades des boat people sont donc d’une part les autorités européennes laxistes et immigrationnistes et d’autre part les passeurs. Et, évidemment, les clandestins eux-mêmes que l’on déresponsabilise et victimise et qui n’avaient qu’à rester chez eux pour y vivre entre eux et améliorer leur sort (3).
Quatrièmement, et là gît le plus grave : les professeurs d’hyper morale qui favorisent au nom de l’humanisme l’immigration de peuplement incontrôlée favorisent objectivement la naissance d’une société éclatée de chaos et de violence. La bêtise de l’idéologie humanitaro-gauchiste et l’angélisme de la morale christianomorphe se mélangent comme le salpêtre et le souffre. Très Saint-Père, un peu de bon sens : relisez Aristote et Saint Thomas.
Guillaume Faye (J'ai tout compris, 4 octobre 2013)
Notes :
(1) Avant le renversement de Khadafi par l’OTAN, et avant donc que la Libye ne devienne un territoire d’anarchie tribalo-islamique, il existait des accords pour stopper ces transits par mer.
(2) Depuis le début de 2013, 22.000 pseudo-réfugiés en provenance d’Afrique ont débarqué sur les côtes italiennes, soit trois fois plus qu’en 2012 . C’est le Camp des Saints…
(3) En terme de philosophie politique, je rejette l’individualisme. Un peuple est responsable de lui-même. Le fait de légitimer la fuite de ces masses d’individus hors de leur aire ethnique du fait de la ”pauvreté”, de la ”misère” ou de n’importe quoi d’autre, revient à reconnaître l’incapacité globale de ces populations à prendre en main leur sort et à vivre entre elles harmonieusement. C’est peut-être vrai, mais alors qu’elles n’exportent pas en Europe leurs insolubles problèmes.
-
A propos du printemps arabe...
Vous pouvez découvrir ci-dessous, dans une vidéo cueillie sur son site, Bernard Lugan présenter avec brio et clarté son dernier livre intitulé Printemps arabe - Histoire d'une tragique illusion. Le livre est disponible ici.
-
Une tragique illusion...
La revue L'Afrique réelle publie un essai de Bernard Lugan, intitulé Printemps arabe - Histoire d'une tragique illusion. Comme toujours, l'auteur, historien et africaniste réputé, disperse les fumées idéologiques et revient aux faits...
Le livre, qui ne sera pas diffusé en librairie, est disponible en ligne sur le site de Bernard Lugan.
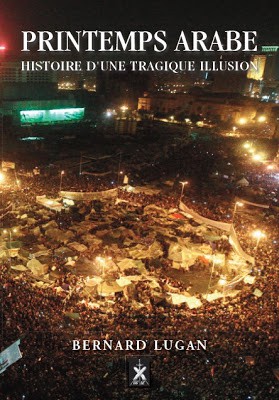 " En 2010-2011, la Tunisie, l’Egypte et la Libye connurent des évènements spécifiques, hâtivement baptisés « printemps arabe » par des journalistes voulant y voir autant d’avancées démocratiques.L’échec de cette tragique illusion est à la hauteur des emballements émotionnels qu’elle suscita:- La Tunisie est en faillite économique et le climat politique y est devenu explosif. Les Frères musulmans au pouvoir veulent faire adopter une Constitution ayant la charia pour norme, ce que refusent des foules de plus en plus nombreuses. La radicalisation des positions est illustrée par l’assassinat de leaders de l’opposition et par la naissance d’une insurrection armée islamiste qui pose de sérieux problèmes à l’armée tunisienne.- En Egypte, ceux qui ne supportaient plus leur vieux chef militaire se sont finalement donnés à de jeunes chefs militaires pour échapper aux « fous de Dieu », ce qui n’empêcha pas le pays de basculer insensiblement dans ce qui risque de devenir une guerre civile.- En Libye, l’Etat n’existe plus. Le nord du pays est partagé entre des milices tribales ou religieuses, cependant que tout le sud est devenu un « Libystan » aux mains des jihadistes.Ce livre, illustré de cartes en couleur et qui n’a pas d’équivalent fait, au jour le jour, l’histoire du prétendu « printemps arabe » en Afrique du Nord. Il met également en évidence ses conséquences géopolitiques nationales, et régionales.Il explique également pourquoi le Maroc et l’Algérie ne furent pas concernés par ces évènements. "
" En 2010-2011, la Tunisie, l’Egypte et la Libye connurent des évènements spécifiques, hâtivement baptisés « printemps arabe » par des journalistes voulant y voir autant d’avancées démocratiques.L’échec de cette tragique illusion est à la hauteur des emballements émotionnels qu’elle suscita:- La Tunisie est en faillite économique et le climat politique y est devenu explosif. Les Frères musulmans au pouvoir veulent faire adopter une Constitution ayant la charia pour norme, ce que refusent des foules de plus en plus nombreuses. La radicalisation des positions est illustrée par l’assassinat de leaders de l’opposition et par la naissance d’une insurrection armée islamiste qui pose de sérieux problèmes à l’armée tunisienne.- En Egypte, ceux qui ne supportaient plus leur vieux chef militaire se sont finalement donnés à de jeunes chefs militaires pour échapper aux « fous de Dieu », ce qui n’empêcha pas le pays de basculer insensiblement dans ce qui risque de devenir une guerre civile.- En Libye, l’Etat n’existe plus. Le nord du pays est partagé entre des milices tribales ou religieuses, cependant que tout le sud est devenu un « Libystan » aux mains des jihadistes.Ce livre, illustré de cartes en couleur et qui n’a pas d’équivalent fait, au jour le jour, l’histoire du prétendu « printemps arabe » en Afrique du Nord. Il met également en évidence ses conséquences géopolitiques nationales, et régionales.Il explique également pourquoi le Maroc et l’Algérie ne furent pas concernés par ces évènements. " -
Au temps des colonies...
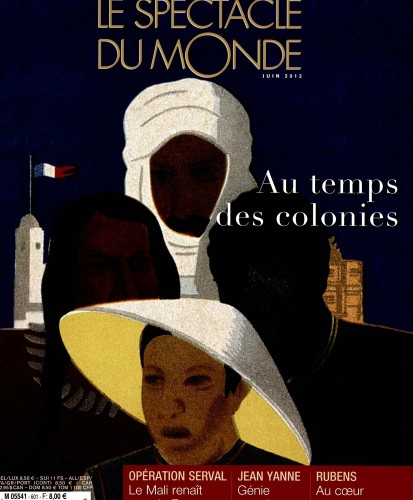
Le numéro de juin 2013 de la revue Le spectacle du monde est en kiosque.
Le dossier est consacré au temps des colonies. On pourra y lire, notamment, des articles de Philippe Conrad ("Aux origines de « la plus grande France » " ), de François d'Orcival ( "1894-2013, les deux prises de Tombouctou" ), de François Bousquet ("Une idée de gauche et de droite"), de Christian Brosio ("Lyautey, colonial anticolonialiste") ou de Philippe d'Hugues ("L'aventure coloniale au cinéma") ainsi qu'un entretien avec Bernard Lugan ("Les Africains doivent se décoloniser mentalement").
Hors dossier, on pourra aussi lire des articles de Pierre Robin ("Jean Yanne, génie populiste"), de Michel Thibault ("Musées : des Arts et Traditions populaires au MuCEM"), de François Bousquet ("Barbey d'Aurevilly. Le dandy réfractaire") ou d' Alain de Benoist ("Dominique Venner. Le sacrifice d'un cœur rebelle"). Et on retrouvera aussi les chroniques de Patrice de Plunkett ("Le « gender » et le cannibale") et d'Eric Zemmour ("A l'épreuve des primaires").
-
Cérémonie d'hommage en l'honneur de Dominique venner...
Le 31 mai 2013, six cents personnes se sont réunies à Paris pour rendre un dernier hommage à Dominique Venner. L'équipe de Pro Russia Tv a pu filmé cette cérémonie au cours de laquelle ont pris la parole Bernard Lugan, Philippe Conrad, Jean-Yves Le Gallou, Henry de Lesquen, Guillaume de Tanouarn, Javier Portella, Gianluca Iannone et Alain de Benoist.